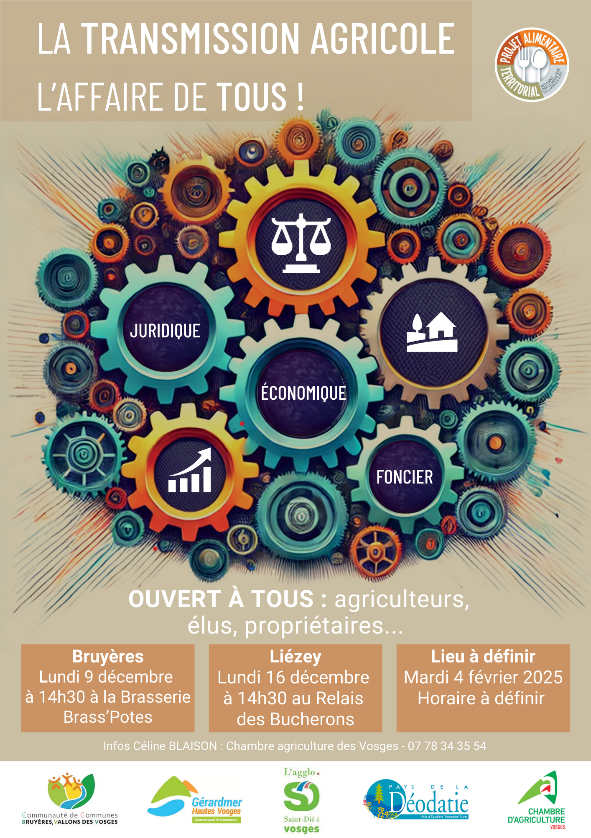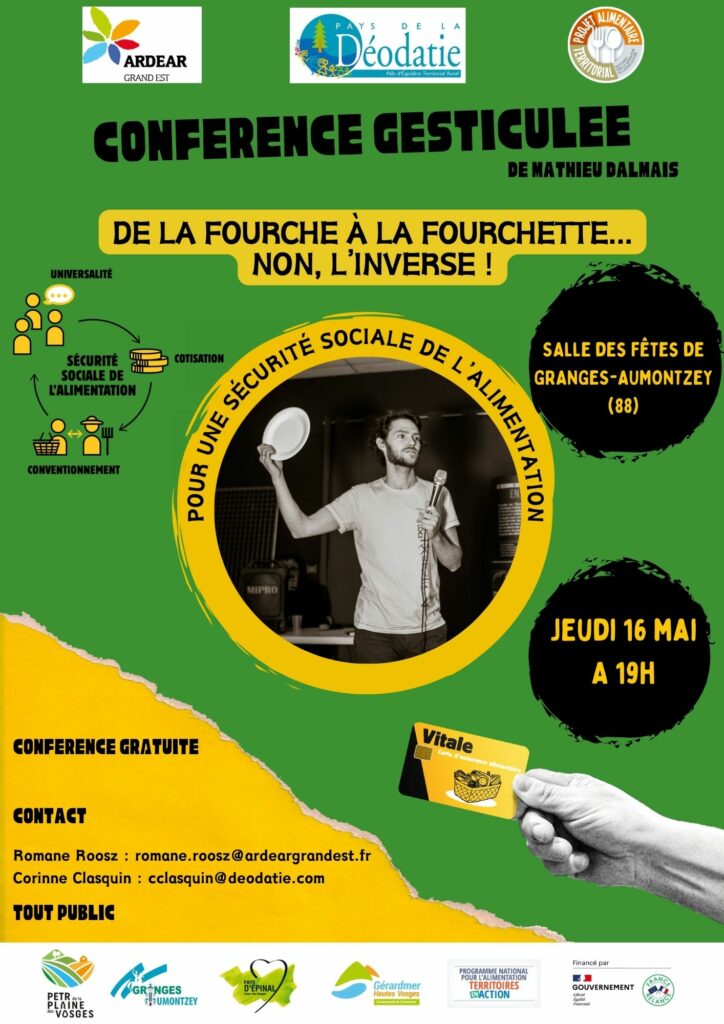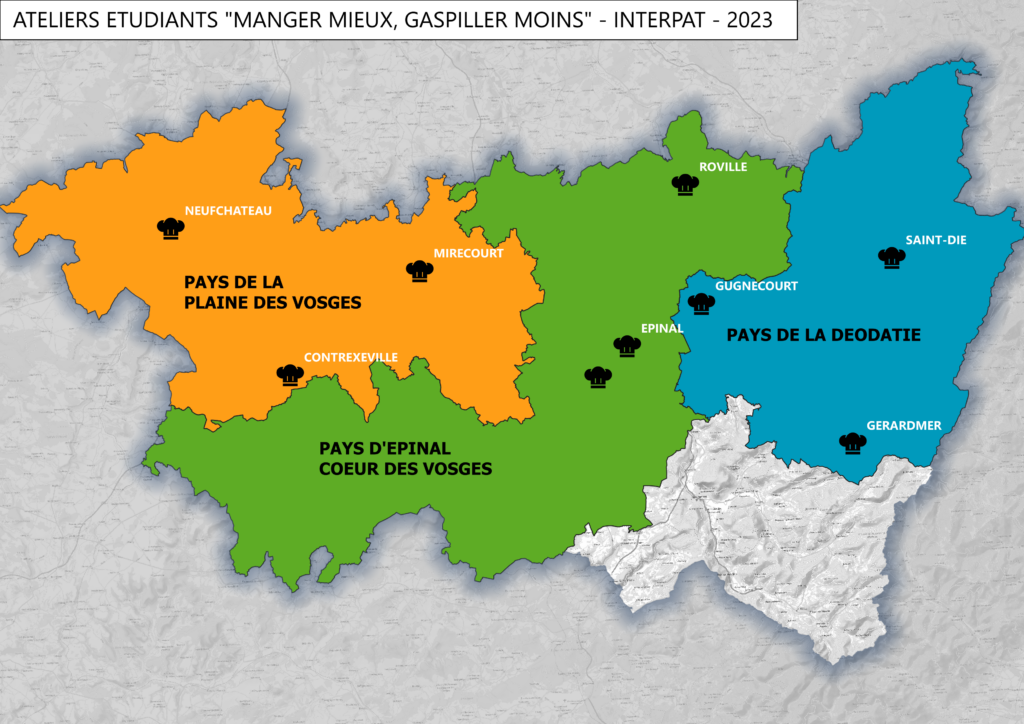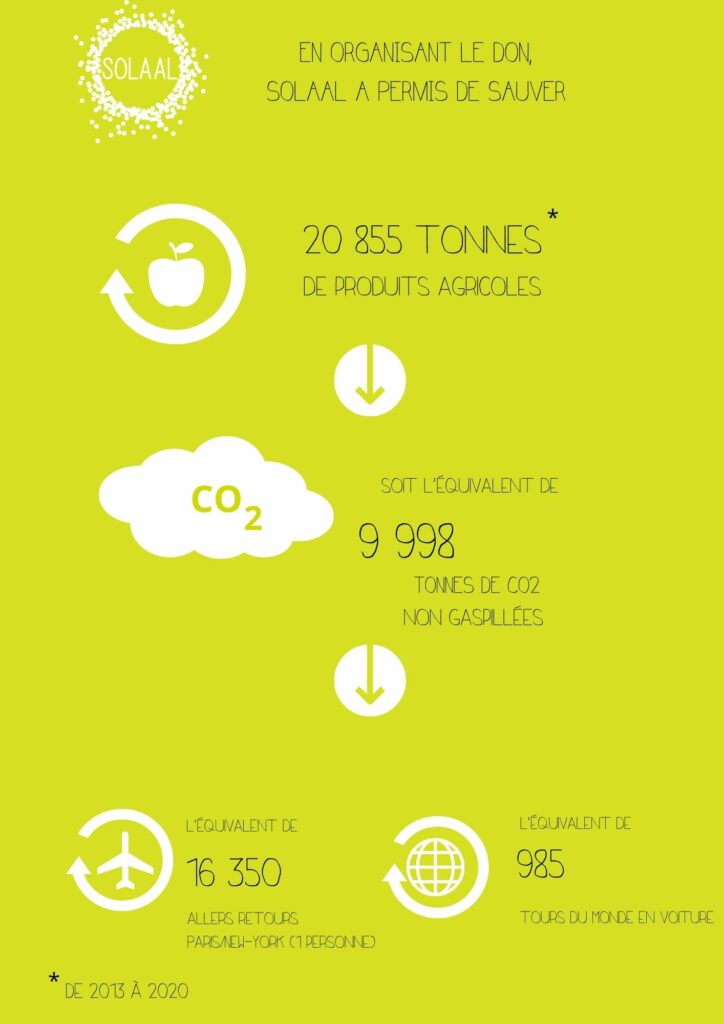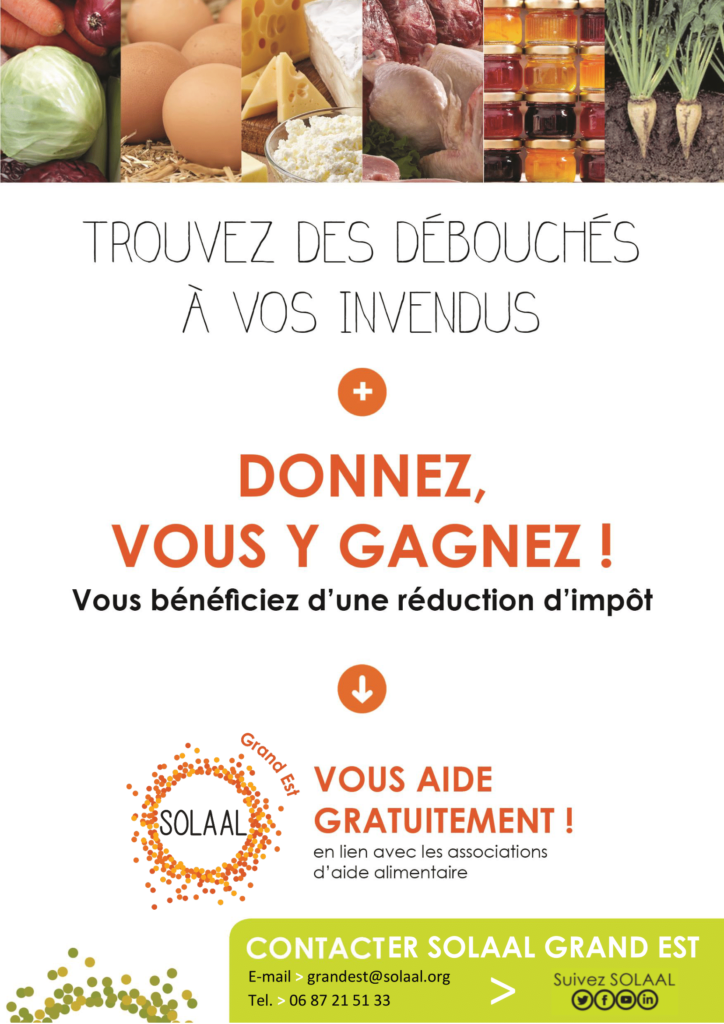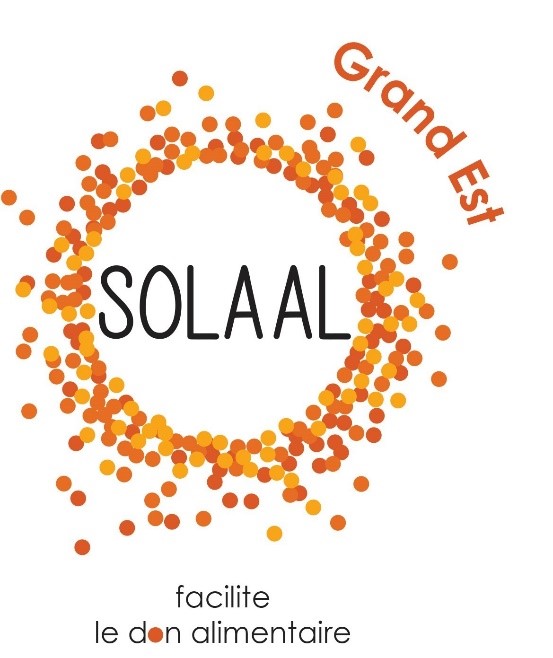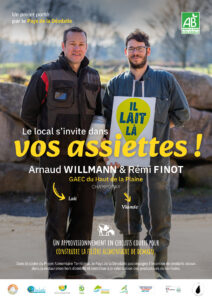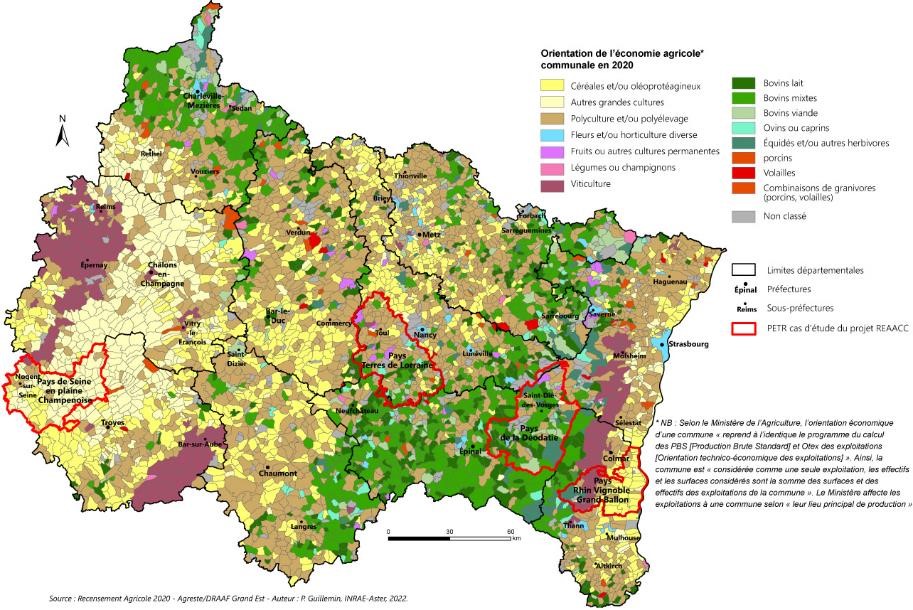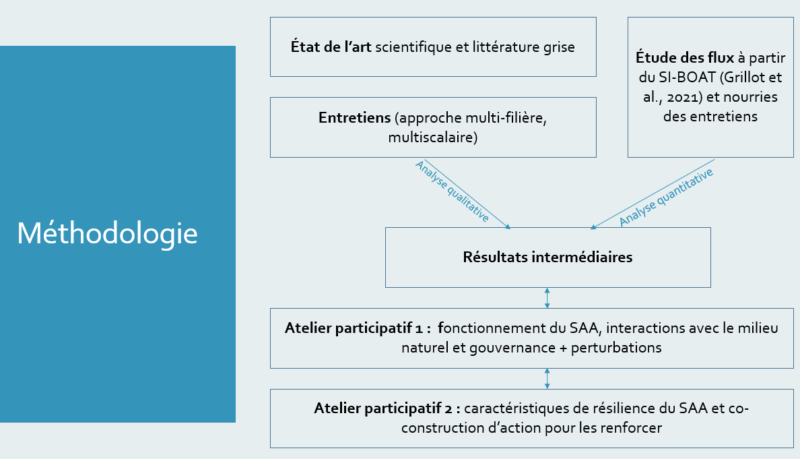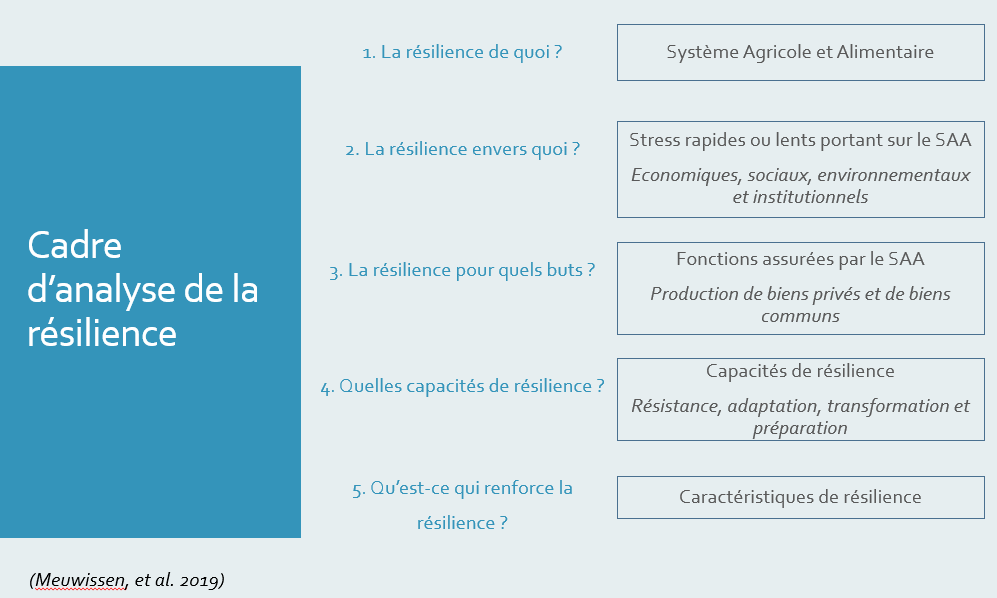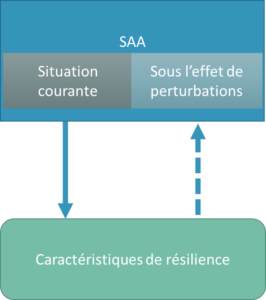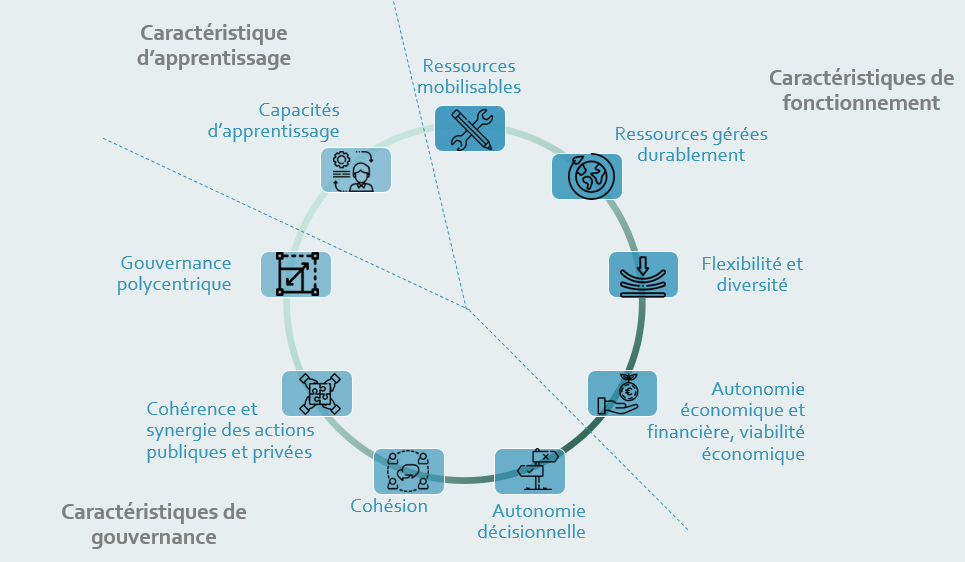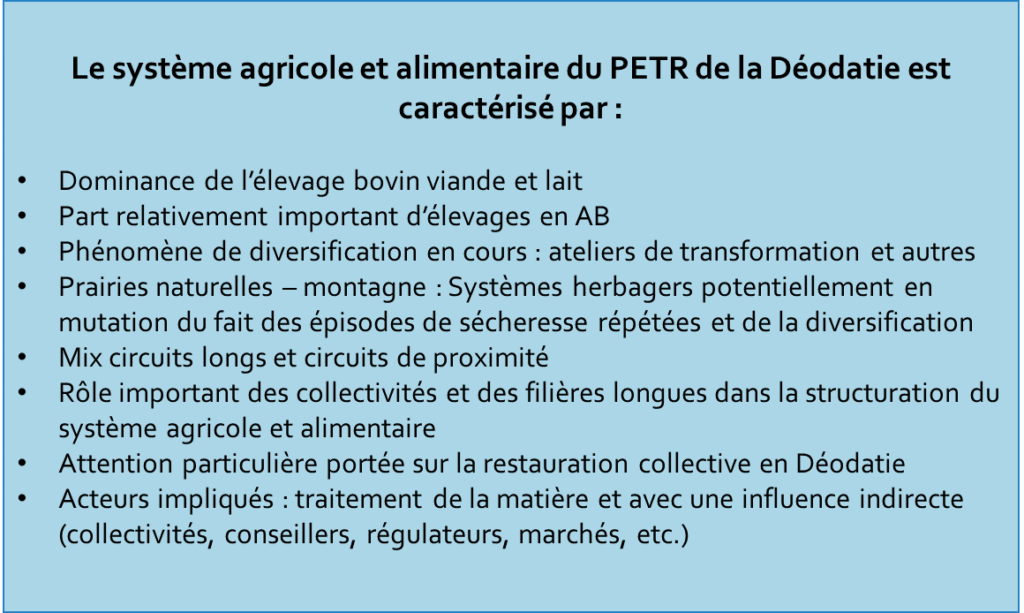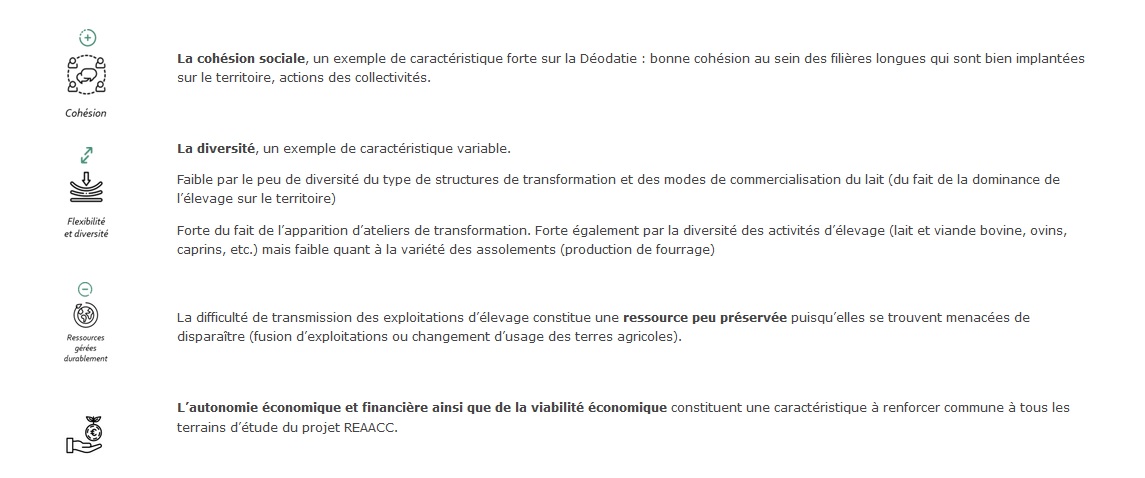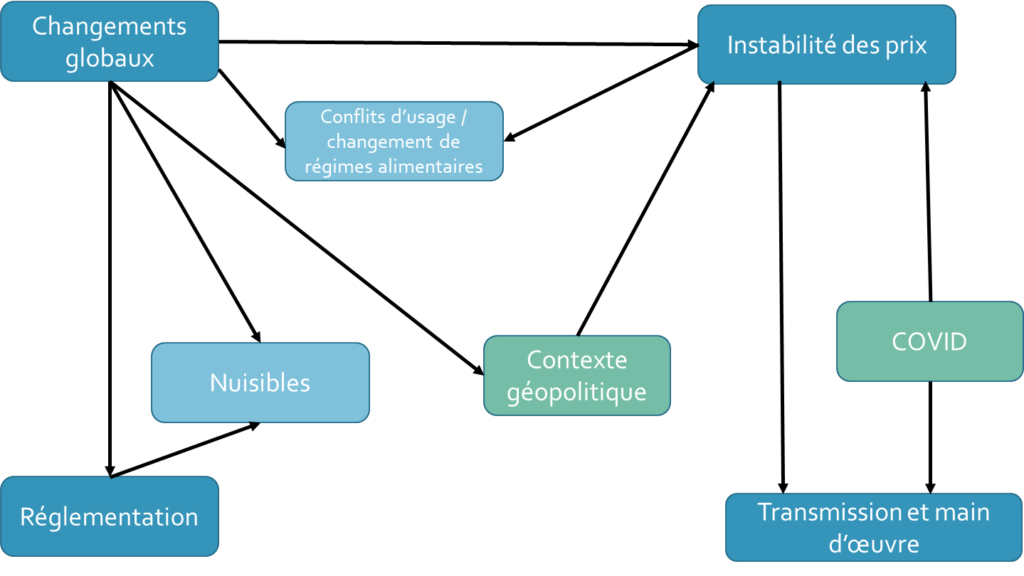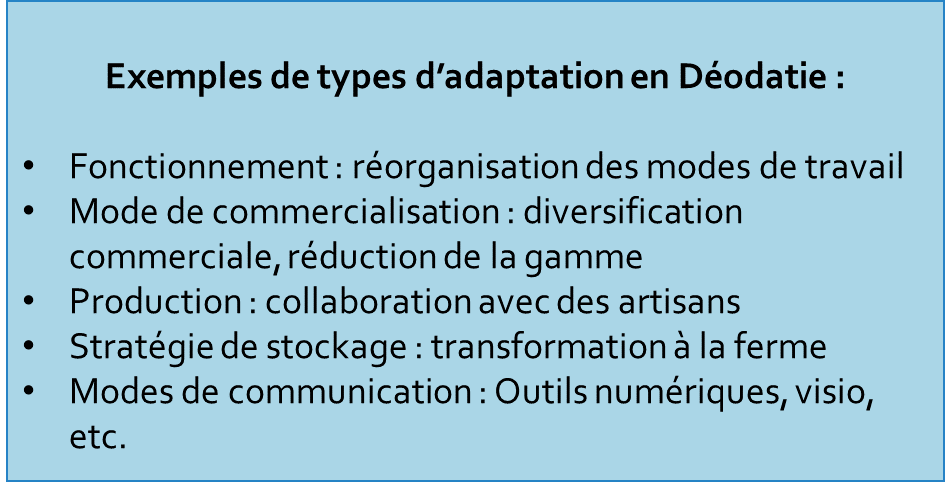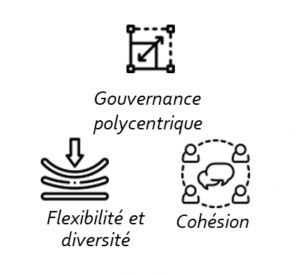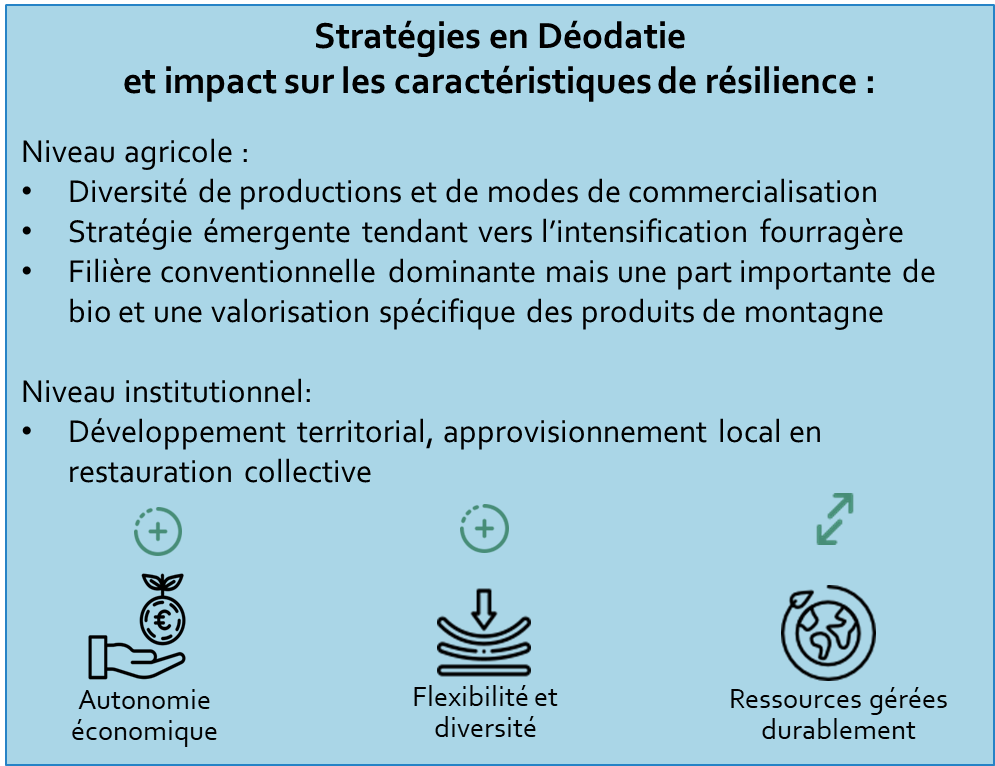CAMPAGNE DE TÉLÉ-DÉCLARATION "MA CANTINE"
En 2025, il convient d’effectuer la télédéclaration de ses données d’achats alimentaires de l’année civile 2024, du 7 janvier au 31 mars 2025.
Depuis septembre 2022, toutes les cantines sont appelées à se référencer sur la plateforme ma cantine pour répondre à l’obligation de télédéclaration des données annuelles d’achats et valoriser leur démarche EGAlim (arrêté du 22 septembre 2022).
LA CAMPAGNE DE TÉLÉ-DÉCLARATION "MA CANTINE" A DÉMARRÉ POUR 2025
Voici quelques points à vérifier pour effectuer cette remontée de données :
Avez-vous bien créé votre ou vos cantines sur la plateforme ?
- Avez-vous bien inscrit le lieu de restauration (et non la commune) ?
- Pilotez-vous vos achats selon la nomenclature demandée ?
- En cas de gestion par un prestataire, lui avez-vous transmis les informations requises ?
Découvrez cette anti-sèche pour vous accompagner dans la démarche :
⚠️ Cas des cuisines centrales : vous devez recenser tous les sites livrés par vos soins.
En effet, sans cette démarche, vos sites livrés ne pourront bénéficier de la télédéclaration centralisée.
Des difficultés ? Contactez support-egalim@beta.gouv.fr
QUI EST CONCERNÉ ?
Que vous soyez en régie, en gestion concédée, en tant que donneur d’ordre légal vous devez vous assurez que votre ou vos restaurants scolaires sont inscrits sur la plateforme “ma cantine” : https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil
POURQUOI S'INSCRIRE ?
Pour bénéficier des outils ma cantine :
- Des ressources fiables et réglementaires ;
- Des outils gratuits pour piloter vos achats EGAlim et locaux ;
- Des supports de communication.
COMMENT S'INSCRIRE ?
Créer un compte sur ma cantine : https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/creer-mon-compte
Actualités – Alimentation :